Peut-on utiliser librement une image ?
Publié le :
10/09/2020
10
septembre
sept.
09
2020
Focus / Propriété intellectuelle - Nouvelles technologies
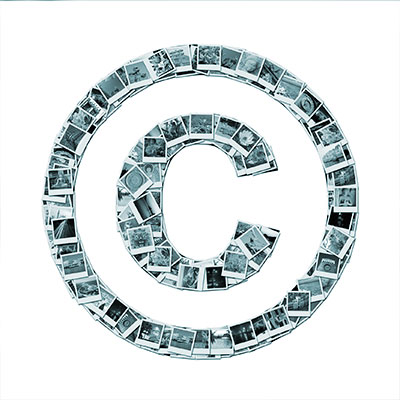
A l’instar de nos « Le Saviez-Vous », la grande majorité des contenus consultables sur internet sont accompagnés d’une image permettant de les illustrer. Comme l’écrit, les visuels sont protégés, toutes les images sur internet ne sont pas exploitables…
Les images sont protégées par le droit d’auteur, c’est-à-dire qu’elles appartiennent à leur auteur et ne peuvent pas être librement utilisées, notamment par diffusion, impression, etc… même si cette utilisation est faite à titre gratuit, sans l’autorisation de ce dernier, sous peine que l’action soit considérée comme un acte de contrefaçon.
Régulièrement, la protection de l’image est visible par la mention « tous droits réservés » : ® ou , « Copyrigth » ©.
Le propriétaire de l’image peut également y apposer un filigrane numérique, visible (comme son nom) ou invisible (marquage numérique).
Toutefois, l’absence de telles identifications ne signifie pas que l’image n’est pas protégée.
Pour utiliser une image sans risque il existe deux possibilités.
La première et de se tourner vers les images que l’on trouve gratuitement sur internet, librement diffusables. Si l’image est soumise à une licence « Creative Commons », il faut vérifier les conditions d’utilisation accordées : modifications possibles, usage commercial ou personnel, etc…
La seconde est d’acheter des images dîtes « libre de droits » sur une banque d’images, ce qui confère une utilisation illimitée dans les conditions imposées par la licence d’utilisation, gérée par la plateforme qui vend l’image.
Pour des questions en matière de propriété intellectuelle, contactez les avocats spécialisés inscrits sur Meet laW !








