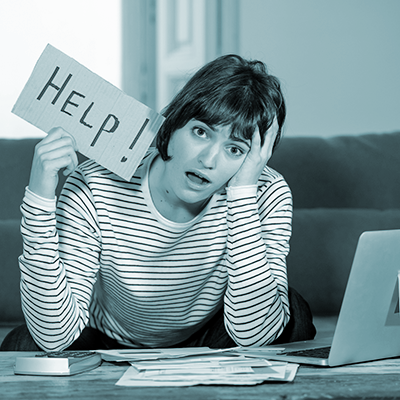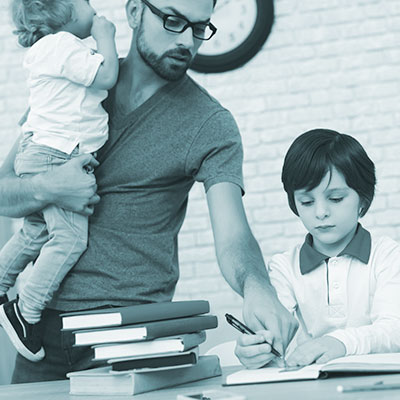Se constituer partie civile
Publié le :
12/11/2020
12
novembre
nov.
11
2020
Focus / Pénal

En matière pénale, la partie civile est la victime dans un procès qui intervient dans la procédure afin d’obtenir réparation de son préjudice…
Toute personne qui s’estime victime d’un délit ou d’un crime peut se constituer partie civile, soit avant un procès, soit au cours de celui-ci, contre l’auteur de l’infraction. La seule condition est d’avoir subit un préjudice en lien direct avec l’infraction.
Il existe deux manières de se constituer partie civile :
- Au moment du dépôt de plainte, en déposant une plainte avec constitution de partie civile ;
- À tout moment de la procédure lorsque l’action publique est engagée contre l’auteur de l’infraction ;
L’action publique est celle qui est engagée contre l’auteur de l’infraction et dirigée par le ministère public au nom de la société, puisque l’infraction cause un trouble à l’ordre public.
Dans le premier cas de figure, la constitution de partie civile est enregistrée au même moment que la plainte, que celle-ci soit directement formulée au Procureur de la république par courrier, ou déposée en commissariat ou gendarmerie.
La victime doit alors chiffrer le montant de son préjudice, dans le cadre d’une demande de dommages et intérêts, en fournissant tous les justificatifs nécessaires.
Lorsque l’action publique est en cours et qu’il n’y a pas encore eu d’audience, une simple lettre recommandée avec accusé de réception adressée au minimum 24 heures avant le procès, au greffe du Tribunal qui va juger le litige, suffit pour se constituer partie civile. Le courrier en question doit mentionner vos coordonnées, le montant des dommages et intérêts réclamés et le préjudice subi.
Vous pouvez également vous présenter au greffe du Tribunal qui juge l’affaire le jour même du procès pour vous constituer partie civile, et ce jusqu’à ce que le Procureur de la République ait pris la parole pour énoncer la condamnation qu’il requiert à l’encontre de l’auteur (réquisitoire).
Les personnes morales peuvent également se constituer parties civiles. Un mineur ne peut pas porter plainte seul, ses représentants légaux peuvent le faire en son nom, une personne sous tutelle le fera par le biais de son tuteur et celle sous curatelle sera assistée dans ses démarches par son curateur.
La partie civile à un procès peut se faire représenter par un avocat, bien qu’il ne s’agisse pas d’une obligation.
Les avocats présents sur Meet laW vous apportent tous leurs conseils, vous représentent et vous assistent devant les juridictions pénales !